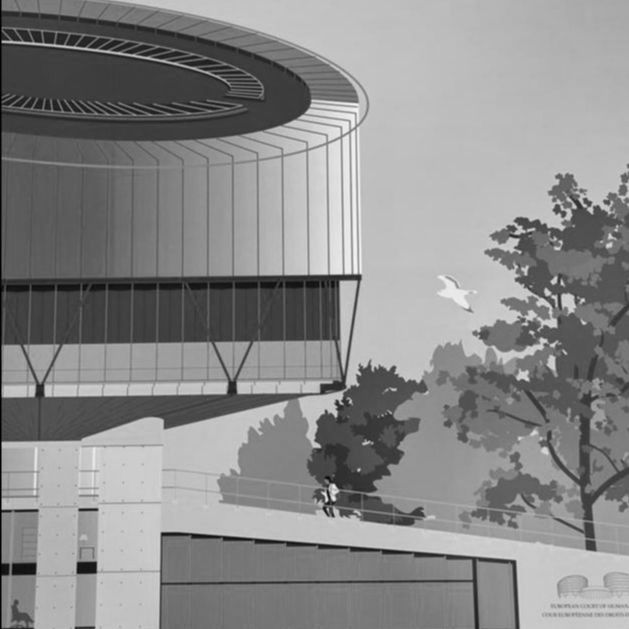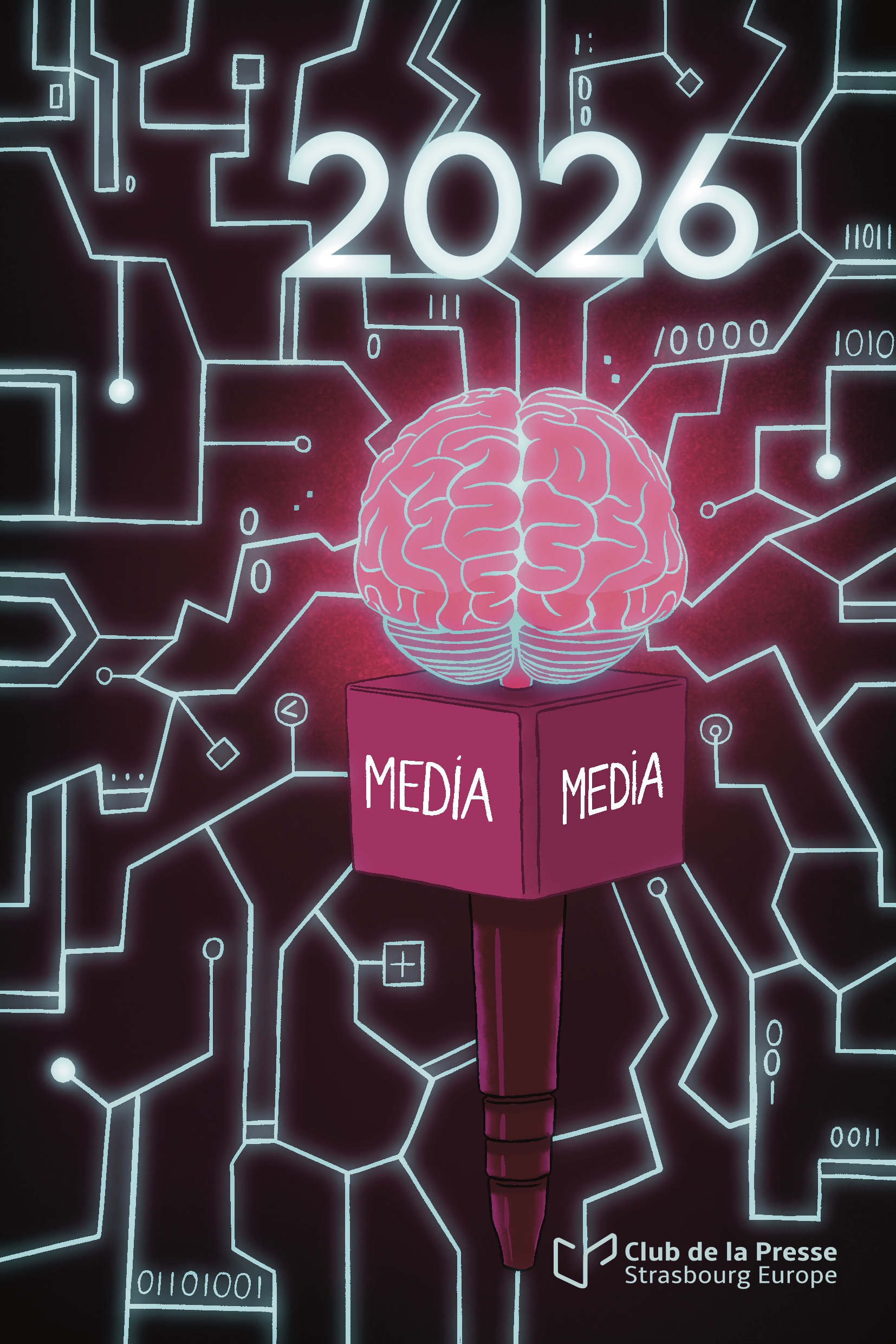Le Palais des droits de l’homme a été construit en 1995 et est signé par le cabinet d’architecture RSHP.
La Cour européenne des droits de l’homme CEDH instituée en 1959 par le Conseil de l’Europe – qui a pour mission d’assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des droits de l’homme – y siège depuis sa mise en service.
La CEDH est le garant de la liberté d’expression, telle que consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est la pierre angulaire de la protection de la presse en Europe.
• L’article 10 de la Convention stipule que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. » La CEDH interprète largement cette disposition pour protéger non seulement le droit d’exprimer des opinions, mais aussi celui de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations. Pour les journalistes, c’est une protection essentielle dans leur mission d’informer le public.
• La CEDH a établi de manière constante que la protection des sources journalistiques est une condition fondamentale de la liberté de la presse. Sans cette protection, la capacité des journalistes à obtenir des informations sur des sujets d’intérêt public serait gravement entravée.
• Si la liberté d’expression n’est pas absolue et peut être soumise à des restrictions (pour la sécurité nationale, la protection de la réputation d’autrui, etc.), la CEDH exige que ces restrictions soient prévues par la loi, poursuivent un but légitime et soient « nécessaires dans une société démocratique ». Cela signifie que la Cour examine la proportionnalité des mesures prises par les États contre les journalistes, garantissant qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
• La CEDH reconnaît le rôle essentiel de « chien de garde » des médias dans une société démocratique. Elle estime que la presse doit pouvoir communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui peuvent « offenser, choquer ou perturber l’État ou une quelconque partie de la population ». Cela donne aux journalistes une marge de manœuvre cruciale pour la critique et l’investigation.
• La Cour intervient souvent dans des affaires où des journalistes sont poursuivis pour diffamation, atteinte à la vie privée, ou pour la publication d’informations confidentielles. Elle examine si les sanctions (amendes, peines de prison) sont proportionnées et si elles ne créent pas un « effet dissuasif » sur la liberté de la presse.
• La CEDH a également jugé que le refus d’accès à certaines informations, notamment des décisions de justice, peut constituer une violation de la liberté d’expression des journalistes, renforçant ainsi leur droit de rechercher l’information.
La CEDH a rendu plusieurs décisions essentielles qui ont façonné la jurisprudence en matière de liberté de la presse. Voici quelques exemples
Nom du requérant Pays condamné Année
Goodwin Royaume-Uni (1996) : C’est un arrêt emblématique. La Cour a jugé qu’ordonner à un journaliste de révéler ses sources, sous peine de sanction, constitue une ingérence disproportionnée dans sa liberté d’expression. Elle a affirmé que la protection des sources est une des pierres angulaires de la liberté de la presse et ne peut être levée que dans des circonstances exceptionnelles et impérieuses, où l’intérêt public prépondérant l’exige.
> Dans cette affaire, un journaliste avait refusé de révéler sa source pour un article basé sur des informations confidentielles sur une entreprise.
Roemen et Schmitt Luxembourg (2003) : Cette affaire a réaffirmé le principe de la protection des sources journalistiques, même lorsque des documents sont saisis chez un journaliste. La Cour a jugé que la perquisition du domicile d’un journaliste et la saisie de documents, y compris ceux qui pourraient révéler ses sources, constituent une ingérence grave dans la liberté d’expression.
> L’article du journaliste Robert Roemen portait sur un fait établi relatif à une condamnation fiscale prononcée à l’encontre d’un ministre. Selon la Cour, il ne fait pas de doute qu’il a ainsi débattu d’un sujet d’intérêt général et qu’une ingérence « ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public« .
Magyar Helsinki Bizottság Hongrie (2016) : Cet arrêt a marqué une évolution importante en reconnaissant, dans certaines conditions, un droit d’accès à l’information détenue par les autorités publiques, en particulier pour les journalistes et les chercheurs qui s’intéressent à des questions d’intérêt public. La Cour a souligné que le refus d’accès à l’information peut, dans certains cas, constituer une ingérence dans la liberté d’expression.
Sabuncu et autres c. Turquie (2020) : Cette affaire concerne la détention prolongée de plusieurs journalistes et dirigeants du journal Cumhuriyet en Turquie, accusés de liens avec des organisations terroristes. La CEDH a jugé que leur détention préventive avait violé l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 10, estimant que l’assimilation déraisonnable de leur ligne éditoriale à de la propagande terroriste était contraire aux principes de la liberté de la presse et créait un « effet dissuasif » sur le journalisme critique.
Standard Verlagsgesellschaft mbH Autriche (2021) : Cet arrêt a abordé la question de la protection des sources dans le contexte des commentaires en ligne. La CEDH a jugé que des décisions de justice ordonnant à un média de révéler les données d’inscription d’utilisateurs ayant posté des commentaires sur son site web pouvaient violer l’article 10, si la mesure n’était pas justifiée par un besoin social impérieux et si elle était de nature à dissuader les sources potentielles d’informer le public.
> Un journal autrichien, touché par des ordonnances judiciaires, avait refusé de communiquer ces données et avait saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.
Sedletska Ukraine (2021) : Dans cette affaire, une journaliste ukrainienne avait fait l’objet d’une ordonnance de justice l’obligeant à fournir des données de son téléphone et de son ordinateur portable dans le cadre d’une enquête sur la divulgation de secrets d’État. La CEDH a conclu à une violation de l’article 10, jugeant que l’ordonnance manquait de justification suffisante et était disproportionnée. La Cour a rappelé la nécessité de motifs particulièrement convaincants pour justifier une ingérence dans la protection des sources journalistiques.
Association Confraternelle de la Presse Judiciaire et Autres c. France (2022) : Bien que cet arrêt ne soit pas directement une condamnation de la France pour une violation liée à un journaliste, il est très pertinent. La CEDH a examiné les garanties offertes par le droit français en matière de conservation et d’exploitation des données de connexion par les services de renseignement. La Cour a souligné l’importance de garanties spécifiques et renforcées pour les professions protégées, dont les journalistes, pour éviter des atteintes disproportionnées à la protection de leurs sources. L’arrêt a insisté sur la nécessité d’une autorisation préalable par une entité indépendante et d’un contrôle juridictionnel effectif.
Giesbert et autres c. France (2024) : Cet arrêt concerne la condamnation pénale pour diffamation de journalistes français. La CEDH a confirmé que la condamnation des requérants pour diffamation publique constituait une ingérence dans leur liberté d’expression. Toutefois, elle a estimé que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime (protection de la réputation) et était proportionnée dans une société démocratique, compte tenu notamment de la marge d’appréciation des États dans ce type d’affaires et des « devoirs et responsabilités » des journalistes.
Anka Wessang